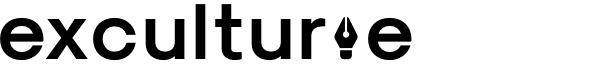Ce matin et au cours de la journée d’hier, on l’a vu et on l’a entendu: au cinéma, la censure est une réalité qui a existé et qui existe toujours sous des formes certes moins visibles, mais bien réelles. Elle intervient durant toutes les phases de l’élaboration d’une oeuvre cinématographique, de la recherche de financement à la projection, comme l’ont illustré plusieurs intervenants. Un sujet est cependant rarement abordé dans le cadre d’une discussion sur la censure, c’est le rôle des commissions et autres organismes publics du même type qui classent les films en fonction de catégories d’âges déterminées par la loi.
Il est légitime pour un juriste d’interroger ces dispositifs face aux exigences de la liberté d’expression, comme l’a fait notamment mon collègue, le professeur Jacques Viguier, dans d’autres circonstances1. Jérémy Houllière vient d’illustrer le rôle joué par le Bureau de censure des vues animées au Québec2. Et c’est précisément au modèle québécois que je me suis intéressé. Historiquement, la censure cinématographique s’est appuyée là-bas sur des institutions étatiques, le plus souvent pressées en ce sens par les autorités religieuses3
Aujourd’hui, la Régie du cinéma, héritière des institutions qui l’ont précédée, restreint l’accès aux salles de cinéma et à l’emprunt de copies de films à certains groupes de personnes en fonction de leur âge. On peut se demander si cette pratique est une victoire sur la censure ou si elle n’est pas plutôt un relent de cette même censure? Porte-t-elle atteinte à la liberté d’expression et, si c’est le cas, cette atteinte se justifie-t-elle dans une société libre et démocratique?
Les mécanismes juridiques de la censure cinématographique
Au moment des premières projections cinématographiques au Québec, en juin 1896, un Acte relatif aux exhibitions publiques dans le Bas-Canada existait déjà. La loi prévoyait que toute «exhibition publique de monstres, d’idiots ou d’autres personnes imbéciles ou difformes tendant à compromettre la sûreté ou la morale publique
»4 pouvait être prohibée par les conseils locaux. Les élus municipaux pouvaient difficilement prétendre régir le cinéma naissant sur la base d’une disposition aussi éloignée du cinématographe.
Le nouveau divertissement, de plus en plus populaire auprès de la classe ouvrière, s’est donc développé sans contraintes dans un premier temps, au grand dam des membres du clergé. Ils réclamaient qu’on interdise l’exploitation des salles de vues animées le dimanche. Et, à défaut d’une telle interdiction, qu’on préserve au moins les enfants de ce spectacle5.
Une première réponse aux préoccupations ecclésiastiques a vu le jour, en 1907, sous la forme d’une Loi concernant l’observance du dimanche. Elle interdisait de donner ou de prendre part à des représentations théâtrales le jour du Seigneur6. La loi a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada parce qu’elle ne respectait pas le partage des compétences entre le gouvernement fédéral et les provinces7. On était alors bien loin d’évoquer la question de la liberté d’expression.
Avant même son invalidation, le législateur québécois avait adopté une nouvelle loi interdisant l’entrée des mineurs âgés de moins de 15 ans dans les salles obscures, à moins qu’ils ne soient accompagnés8. À l’occasion de l’étude de la loi, un député avait proposé qu’on exerce une censure sur les vues présentées au public plutôt que de simplement interdire l’admission des enfants9. L’année suivante, l’Assemblée législative du Québec mettait en place un Bureau de censure des vues animées avec pour mandat d’examiner tous les films qui lui étaient soumis et d’en permettre ou d’en refuser la diffusion10.
Le 9 janvier 1927, un incident tragique a renforcé une conviction largement partagée que le cinéma était mauvais pour la jeunesse: l’incendie d’une salle de cinéma, à Montréal, a coûté la vie à 78 enfants et adolescents11. Une commission d’enquête a été mise sur pied pour faire toute la lumière sur les événements12. Le rapport de la commission recommandait que les enfants de moins de 16 ans, même accompagnés, ne soient plus admis dans les cinémas13, recommandation mise en oeuvre dès l’année suivante14.
Dans la foulée, le Bureau de censure s’est doté de lignes directrices formelles pour évaluer les films15; des directives dérivées du Code Hays16ma et dont Chloé Delaporte17nsure s’étendait non seulement à l’acceptation ou au refus d’un film, mais aussi à la modification des oeuvres soumises afin de les rendre conformes à ces directives. De nombreuses oeuvres sont sorties en salles mutilées ou reconstruites jusqu’à l’absurde18. Et les films français en ont été l’une des principales victimes19.
C’est peut-être l’interdiction du chef-d’oeuvre de Marcel Carné Les enfants du paradis, en 1947, qui a déclenché le combat contre la censure cinématographique au Québec20. On a toutefois dû attendre le début des années 1960 pour que le vent de contestation qui a soufflé dans le monde du cinéma durant toutes ces années emporte le système de censure. En 1967, la censure légale était officiellement abolie et remplacée par un système de visas accordés en fonction de trois catégories d’âge par le nouveau Bureau de surveillance du cinéma21. Le système est vite apparu insatisfaisant22 et la censure de fait était toujours une triste réalité23.
Le classement24 des films et la liberté d’expression
Après plusieurs tentatives de réformes avortées, une nouvelle loi a vu le jour en 1983. C’est cette loi qui réglemente toujours le cinéma au Québec. La Régie du cinéma, qui a pris le relai du Bureau de surveillance, s’est vu attribuer deux rôles distincts, soit celui de classer les films et celui de délivrer les permis d’exploitation et de distribution25. La loi assujettit dorénavant l’exploitation d’un «lieu de présentation de film en public
»26 et l’activité de «vendre, louer, prêter ou échanger des copies de film
»27 à l’obtention d’un permis. De plus, un visa attestant leur classement doit être apposé sur toutes les copies de films projetés en public ou vendu dans le commerce28.
Si la Régie est d’avis que le contenu d’un film «ne porte pas atteinte à l’ordre public ou aux bonnes moeurs, notamment en ce qu’il n’encourage ni ne soutient la violence sexuelle
», elle le classe «en vue de la protection de la jeunesse
»29 dans l’une des quatre catégories prévues par la loi: «visa général», si elle estime que le film peut être vu par des personnes de tous âges; «13 ans et plus»; «16 ans et plus»; et «18 ans et plus». Ce système est-il compatible avec la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés30?
Les premières décisions favorables à la liberté d’expression concernaient surtout la protection du discours politique et la liberté de la presse31. Plus tard, la Cour suprême du Canada a reconnu que «la liberté d’expression […] ne peut se limiter à l’expression politique
»32 et s’étend notamment aux films. Ceux-ci constituent une forme d’expression protégée, comme le rappelle la Cour, puisque l’«expression artistique est au coeur des valeurs relatives à la liberté d’expression
»33.
Force est toutefois de constater qu’au Québec, le cinéma ne jouit pas de la même liberté que la danse, la musique ou la photographie, par exemple. L’expression cinématographique est soumise à une demande de visa attestant le classement de toutes les oeuvres communiquées au public et à une demande de permis d’exploitation ou de distribution pour chaque lieu de communication ou de diffusion de ces oeuvres. Cette double obligation légale équivaut à une autorisation préalable puisqu’il s’agit d’un régime préventif34 qui intervient en amont de l’expression.
Le système de classement des films, tel qu’il existe au Québec et dans la majorité des provinces canadiennes, et l’obligation de détenir un permis d’exploitation d’un écran de cinéma ou de distribution comportent à n’en pas douter une atteinte à la liberté d’expression. Il reste à s’interroger à savoir si cette limite à la liberté d’expression est raisonnable et peut se justifier dans une société libre et démocratique. La Charte canadienne prévoit en effet que les droits et libertés qu’elle garantit peuvent être restreints «par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer
»35.
La Cour suprême a dégagé, dans son arrêt de principe R. c. Oakes36, un test en quatre étapes que doit satisfaire la partie qui prétend au maintien d’une «règle de droit
» violant une liberté ou un droit fondamental reconnu par la Charte. L’État doit démontrer que la mesure qu’il entend justifier poursuit un «objectif urgent et réel
». Il doit ensuite établir l’existence d’un «lien rationnel
» entre l’objectif poursuivi et les moyens utilisés. Le moyen choisi doit porter le moins possible atteinte au droit protégé. Et, enfin, les effets bénéfiques de la mesure prise doivent l’emporter sur ses effets préjudiciables.
L’objectif principal poursuivi par le classement des films par catégories d’âges est la «protection de la jeunesse
»37, tel que le stipule la Loi sur le cinéma. L’obligation de détenir un permis d’exploitation ne répond, au terme de la loi, qu’à l’objectif que le lieu de présentation de films soit conforme à certaines normes techniques38. Le gouvernement pourrait également soutenir qu’un tel permis permet de s’assurer que son détenteur respecte ses obligations vis-à-vis de la protection de la jeunesse. La détention du permis de distributeur ne semble d’ailleurs répondre à aucun autre objectif avoué que celui-ci39.
Il est intéressant de noter que les restrictions quant à l’admission des mineurs aux films classés n’affectent pas la distribution libre des livres desquels ces films sont parfois adaptés. Le cinéma ne devrait-il pas être traité comme l’écrit l’est généralement aujourd’hui? On peut aussi se demander si la protection de l’enfance doit être du ressort de l’État dans le cas qui nous occupe? Ce rôle ne serait-il pas mieux assuré par les parents? Le classement des films par un organisme public fournirait justement une information précieuse aux parents, mais cette information ne pourrait-elle pas être donnée par une association, comme c’est le cas aux États-Unis?
À ce stade de l’analyse, la Cour entend généralement des experts et consulte des études pour apprécier le caractère urgent et réel de l’objectif de la mesure défendue par l’État. Il faudrait donc convoquer ces études et ces experts sur la réception des images chez les jeunes par tranches d’âges et l’influence que de telles images peuvent avoir sur leur développement pour fournir une réponse définitive aux questions qui se posent. Quoi qu’il en soit, on peut admettre que la volonté de protéger la jeunesse pourrait être reconnue comme une préoccupation urgente et réelle de l’État. Par contre, les motivations liées aux normes techniques des salles de cinéma se conçoivent difficilement comme un tel objectif et ne franchiraient sans doute pas cette première étape.
Le volet suivant de l’analyse consiste à se demander si ce système de classement a un lien rationnel avec l’objectif poursuivi par le législateur. Il ne semble faire aucun doute que ce lien existe entre l’objectif de protéger la jeunesse et de leur interdire l’accès à certaines oeuvres cinématographiques en fonction de leur âge. Les films que les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent visionner comportent des scènes que les employés de la Régie du cinéma estiment ne pas convenir aux catégories de jeunes pour lesquels ces films sont interdits.
L’État pourrait apporter la preuve que ces interdictions reposent sur les plus récentes études en psychologie de l’enfance et qu’elles sont taillées pour qu’elles portent le moins possible atteinte à la liberté d’expression, qui, faut-il le rappeler, s’étend à la faculté de recevoir de l’information40. Le classement en trois catégories d’âge restrictives vise une protection effective des jeunes en fonction de l’avancement de leur développement et répond ainsi positivement au critère de l’atteinte minimale.
Si les trois premiers volets de l’analyse sont axés sur l’objectif poursuivi par le législateur, le dernier met en cause les conséquences de la mesure contestée sur le public dont la liberté d’expression est restreinte41. La conséquence de l’interdiction sur un jeune est de reporter le moment où il pourra voir le film classé. L’interdiction n’est pas totale, mais ciblée. Elle ne vaudra, pour un individu donné, que pour une certaine période en fonction de son âge et de la catégorie à laquelle appartient le film qu’il aurait souhaité voir. La prohibition n’est ainsi pas absolue puisqu’elle n’est que temporaire. Permettre à un jeune de regarder un film pour lequel il n’a pas encore la maturité nécessaire comporterait sans doute des effets plus néfastes pour son développement que l’interdiction. Les effets bénéfiques de la mesure prise semblent donc l’emporter sur ses effets préjudiciables.
Si le système de classement porte atteinte à la liberté d’expression, la justification de cette atteinte peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Il apparaît toutefois douteux que l’obligation de détenir un permis d’exploitation ou de distribution puisse être sauvegardée. Il serait en effet difficile de démontrer qu’il s’agit là d’une préoccupation urgente et réelle. L’obtention d’un permis n’a pas non plus de lien rationnel avec l’objectif gouvernemental de protéger la jeunesse, l’objectif pouvant être atteint d’une manière moins attentatoire à la liberté d’expression. D’autant que la Cour suprême du Canada envisage ce type d’autorisation préalable avec beaucoup de circonspection42.
* Le présent article a été établi sur la base du texte d’une présentation donnée, le 30 juin 2012, dans le cadre des Ves Rencontres Droit et cinéma – Censure et cinéma, un événement organisé par l’Université de La Rochelle, à La Rochelle.
1 Jacques Viguier, «Que devient la liberté d’expression cinématographique?», in Pouvoir et liberté – Études offertes à Jacques Mourgeon, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 687; et J. Viguier, «L’expression cinématographique en France: liberté réelle ou/et liberté formelle?», in Mélanges offerts à Jean-Pierre Marichy, Toulouse, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse, 2003, p. 151.
2 À l’épreuve de la censure: His Girl Friday et le Bureau de censure des vues animées de la province de Québec.
3 Yves Lever, «L’Église et le cinéma – Une relation orageuse», Cap-aux-Diamants, été 1994, p. 24.
4 [Des exhibitions publiques], SRQ 1888, art. 2939.
5 Harry Bernard, «Théâtre et cinéma – L’ennemi dans la place», L’Action française, août 1924, p. 74 à 76, et 79.
6 SQ 1907, c. 42, art. 2.
7 Ouimet c. Bazin, [1912] 46 RCS 502.
8 Loi concernant les exhibitions de vues animées, SQ 1911, c. 34, art. 1. L’âge légal est passé à 16 ans à la fin des années 1910: Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les exhibitions de vues animées, SQ 1919, c. 48, art. 1.
9 Québec, Débats de l’Assemblée législative, 1er mars 1911, p. 473.
10 Loi amendant les Statuts refondus, 1909, concernant les exhibitions de vues animées, SQ 1912, c. 36, art. 1, par. 3713n.
11 Les quotidiens montréalais Le Canada, Le Devoir, La Patrie et La Presse ont consacré une grande partie de leur édition du lundi, 10 janvier 1927, à cette tragédie. Ils ont ensuite publié de nombreux articles sur le sujet au cours des jours, des semaines et des mois suivants.
12 Loi pourvoyant à la création d’une commission royale pour s’enquérir des circonstances de l’incendie du théâtre Laurier Palace, et de certaines autres matières d’intérêt général, SQ 1927, c. 10.
13 Louis Boyer, «Les résultats de l’enquête du juge Boyer sur le cinéma – Texte officiel du rapport du commissaire-enquêteur», Le Soleil, 31 août 1927, p. 1 et 8.
14 Loi modifiant la Loi des vues animées, SQ 1928, c. 60, art. 1.
15 Québec, Bureau de censure des vues animées, Directives (11 mai 1931).
16 Association of Motion Picture Producers/Motion Picture Producers and Distributors of America (Los Angeles), The Motion Picture Production Code of 1930 – A code to govern the making of talking, synchronized and silent motion pictures (mars 1930).
17 The Rise and Fall of Free Speech in America: le code et l’autocensure du cinéma classique hollywoodien.
18 André Lussier, «Les dessous de la censure», Cité libre, juin/juillet 1960, p. 14.
19 André Fortier, «Les films français et la censure de 1930 à 1955», (1991) 8 Cultures du Canada français 44.
20 Anonyme, «Sensation à l’université – Un délégué français quitte une réunion en disant qu’on a insulté son pays; censure», Le Canada, 8 février 1947, p. 1; et André Lussier, Les visages de l’intolérance au Québec – Textes d’hier et d’aujourd’hui, Sillery, Septentrion, 1997, p. 51 et s.
21 Loi sur le cinéma, SQ 1966-67, c. 22.
22 Anonyme, «Manifeste de l’Association professionnelle des cinéastes du Québec – Un autre visage du Québec colonisé», Champ libre, juillet 1971, p. 77; Anonyme [Le comité de rédaction], «Lettre ouverte au ministre des Affaires culturelles», Séquences, octobre 1971, p. 2; et Jean-Pierre Tadros, «L’urgence d’agir», Cinéma Québec, décembre 1974, p. 7.
23 Richard Gay, «Conscience d’une aliénation nouvelle», Cinéma Québec, juin/juillet 1971, p. 9; et Anonyme, «Le Bureau de surveillance du cinéma», Cinéma Québec, janvier/février 1972, p. 26.
24 Le terme «classement» a été préféré à celui de «classification» puisque c’est celui qu’emploie la loi québécoise.
25 Loi sur le cinéma (à jour au 1er mai 2012), LRQ, c. C-18.1, art. 135 (1) et (3).
26 Ibid., art. 91 à 101.
27 Ibid., art. 102 à 110.
28 Ibid., art. 76 et 76.1.
29 Ibid., art. 81.
30 Charte canadienne des droits et libertés, part. I de la Loi constitutionnelle de 1982, ann. B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11, art. 2 b).
31 Louis-Philippe Gratton, «La liberté de presse au Québec, une liberté américaine? Étude sur le droit à la vie privée et la liberté de presse», (1997) 57 R. du B. 913.
32 Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 RCS 712, à la p. 764.
33 R. c. Butler, [1992] 1 RCS 452, à la p. 486.
34 Maxime Dury, «Du droit à la métaphore: sur l’intérêt de la définition juridique de la censure», in Pascal Ory (dir.), La censure en France à l’ère démocratique (1848-…), Bruxelles, Éd. Complexe, 1997, p. 13, à la p. 15.
35 Charte canadienne des droits et libertés, op. cit., art. 1. La Charte des droits et libertés de la personne prévoit un test semblable (LRQ, c. C-12, art. 9.1).
36 R. c. Oakes, [1986] 1 RCS 103.
37 Loi sur le cinéma (à jour au 1er mai 2012), op. cit., art. 81.
38 Ibid., art. 92.1.
39 Règlement sur les permis d’exploitation de lieu de présentation de films en public, de distributeur et de commerçant au détail de matériel vidéo, RRQ, c. C-18.1, r. 4, art. 31 à 33.
40 Re Ontario Film and Video Appreciation Society and Ontario Board of Censors, (1983) 41 OR (2d) 583, à la p. 591 (OHCJ). La décision a été confirmée en appel: Re Ontario Film and Video Appreciation Society and Ontario Board of Censors, (1984) 45 OR (2d) 80 (CAO). De plus, la Charte des droits et libertés de la personne énonce que toute «personne a droit à l’information» (op. cit., art. 44).
41 Alberta c. Hutterian Brethren of Wilson Colony, [2009] 2 RCS 567, par. 76.
42 Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 RCS 1120, par. 78 et 231. La majorité composée de six juges s’est montrée moins défavorable au contrôle préalable que le juge dissident en partie, Frank Iacobucci, appuyé par les juges Louise Arbour et Louis LeBel.