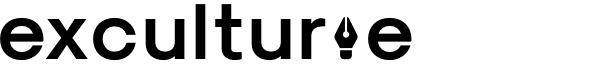La Cour fédérale du Canada a redéfini la notion d’«importance nationale
» d’un bien culturel en restreignant sa portée dans une première décision relative à l’interprétation de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels*. Elle a considéré que la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels est parvenue à une décision «déraisonnable
» en concluant qu’une peinture de Gustave Caillebotte présente une importance nationale pour le Canada**.
Au cours d’une vente aux enchères publiques, le 23 novembre 2016, la maison Heffel a vendu Iris bleus, jardin du Petit Gennevilliers (1892) à la galerie d’art londonienne Richard Green pour la somme de 678 500 $CA. La maison aux enchères canadienne s’est alors adressée à l’Agence des services frontaliers du Canada afin d’obtenir une licence d’exportation pour l’oeuvre. Le document administratif est en effet obligatoire puisque la valeur marchande de la peinture dépasse le seuil fixé par la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée***, soit 30 000 $CA pour un objet d’art fabriqué à l’extérieur du Canada.
Le refus de la licence d’exportation
L’examen de la demande a été confié à l’experte-vérificatrice Michelle Jacques, conservatrice en chef de l’Art Gallery of Greater Victoria. Elle a estimé que la toile de Caillebotte présente un «intérêt exceptionnel
» et revêt une «importance nationale
», au sens de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels [article 11 (1) et (3)]. Elle a en conséquence recommandé de ne pas délivrer la licence d’exportation demandée, une recommandation qui entraîne nécessairement le refus de la licence et l’interdiction d’exporter l’oeuvre à l’extérieur du territoire canadien.
Heffel a présenté une demande en révision de l’avis de refus devant la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels. Le tribunal administratif indépendant, créé en 1977, est parvenu à la même conclusion que l’experte-vérificatrice sur le fond. Il a par ailleurs fixé à six mois le délai durant lequel un établissement ou une administration situé au Canada pourrait acquérir la toile pour «un juste montant
». Le 8 septembre 2017, le Musée des beaux-arts de l’Ontario annonçait son intention de se porter acquéreur des Iris bleus au prix de vente réalisé aux enchères.
À nouveau insatisfait de la décision, l’exportateur a introduit une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale de première instance. Celle-ci se borne à vérifier, dans le cadre d’un tel recours, le respect de l’équité procédurale devant la Commission et si sa décision est «raisonnable
» sur le fond. L’essentiel des débats s’est attaché à déterminer si la Commission avait correctement appliqué le critère d’«importance nationale
» en vertu de la législation en vigueur.
L’application du critère de l’«importance nationale»
La Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels prévoit, à son article 11 (1), qu’une licence d’exportation peut être refusée à tout objet qui «présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences
» et qui «revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national
».
La Commission a évalué l’importance nationale des Iris bleus sur la base de la diversité du Canada et de son multiculturalisme: «La perte d’un objet au Canada pourrait grandement appauvrir le patrimoine national si elle empêchait un segment de la population de connaître ou d’étudier ses traditions culturelles ou celles d’autres Canadiens.
» Elle a appuyé son raisonnement sur le Guide pour l’exportation de biens culturels hors du Canada préparé par Patrimoine canadien. Il prévoit que le terme «patrimoine national
» comprend «les exemples importants de biens culturels étrangers qui démontrent la diversité culturelle du Canada
». La Commission en a conclu que «même si un objet ou son créateur n’a aucun lien avec le Canada
», le bien culturel peut répondre à l’exigence de l’importance nationale.
L’interprétation restrictive de l’«importance nationale»
Le juge Michael D. Manson soutient dans sa décision, rendue le 12 juin 2018, que ces éléments sont insuffisants «pour donner à un objet une importance nationale lorsque ni lui ni son créateur n’ont de lien avec le Canada
». L’interprétation de la Commission est déraisonnable puisque la loi «sous-entend que l’objet doit avoir un lien direct avec le Canada
». Il doit exister un lien plus immédiat avec le patrimoine canadien «que le fait que le Canada est un pays multiculturel et que les Canadiens pourraient vouloir étudier les traditions de l’un des nombreux pays d’où auraient pu provenir leurs ancêtres
». La loi prévoit deux critères «indépendants
», soit ceux de l’«intérêt exceptionnel
» et de l’«importance nationale
», dont l’analyse repose sur des «facteurs distincts
». Elle exige ainsi que l’objet ait «une importance sur le plan culturel
» et que «cette importance soit propre au Canada et aux Canadiens
».
La Commission a limité son analyse au critère de l’«intérêt exceptionnel
», constate le juge Manson. Elle s’est appuyée uniquement sur la provenance, la rareté, la valeur de recherche et l’attrait de l’oeuvre pour rendre sa décision. Elle n’a pas étudié le lien de la toile – importée au Canada dans les années 1960 et jamais exposée au public – ou de l’artiste – un peintre impressionniste français – avec le Canada. Aucun élément n’aurait en définitive permis à la Commission, selon le juge, d’établir un tel lien: «Ni l’artiste ni l’objet n’étaient canadiens, et la peinture n’avait aucun lien avec la population canadienne ni avec l’impressionnisme canadien.
» L’analyse de la Commission ne respecte pas, conclut le juge, l’esprit de la loi, l’objet de celle-ci et l’intention du législateur.
La demande de la maison aux enchères Heffel a été accueillie et la décision de la Commission annulée**. Le juge a renvoyé l’affaire devant la Commission pour qu’elle statut à nouveau, dans une composition différente, en tenant compte des motifs de la décision de la Cour fédérale. Le Procureur général du Canada a annoncé son intention de porter l’affaire devant la Cour d’appel fédérale, tandis que Patrimoine canadien a donné instruction aux experts-vérificateurs et à la Commission d’étudier toute nouvelle demande présentée devant elle en fonction des critères énoncés dans la décision de première instance pendant la durée de la procédure en appel.
* Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, LRC (1985), c. C-51.
** La Cour fédérale d’appel a renversé la décision de première instance dans une décision rendue le 16 avril 2019.
*** Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, CRC, c. 448, groupe V, article 4 b).
Dernière mise à jour: 18 avril 2019
Texte intégral
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Ottawa (Ontario), 12 juin 2018
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE:
HEFFEL GALLERY LIMITED
demanderesse
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7, de la décision de la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels (la Commission) de retarder de six mois la délivrance d’une licence d’exportation à l’égard de l’huile sur toile Iris bleus, jardin du Petit Gennevilliers, 1892, mesurant 21¾ po sur 18¼ po et réalisée par Gustave Caillebotte (la peinture), afin de permettre à un établissement ou à une administration sis au Canada de proposer un juste montant pour l’achat de la peinture, conformément à l’alinéa 29(5)a) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, LRC (1985), ch. C-51 (la Loi).
II. Contexte
[2] La demanderesse exploite un service de vente aux enchères de beaux-arts, possède des bureaux à Vancouver, à Calgary, à Toronto, à Ottawa et à Montréal et exerce ses activités sous le nom commercial et le style «Maison Heffel de vente aux enchères de beaux-arts».
[3] En novembre 2016, la demanderesse a organisé une vente aux enchères publiques où elle a mis la toile en vente. Une galerie commerciale établie à Londres, en Angleterre, a acheté la toile en échange de 678 500 dollars canadiens.
[4] Aux termes de l’article 40 de la Loi, la demanderesse était tenue de demander une licence d’exportation pour envoyer la peinture à Londres, puisque celle-ci appartient au Groupe V de la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, CRC, ch. 448 (la Nomenclature).
[5] Pour déterminer s’il y avait lieu de délivrer une licence d’exportation, un agent a renvoyé la demande à une experte-vérificatrice, conformément au paragraphe 8(3) de la Loi. L’experte-vérificatrice était Mme Michelle Jacques, la conservatrice en chef de la Art Gallery of Greater Victoria (l’experte-vérificatrice). Elle a déterminé que puisque la peinture présentait un «intérêt exceptionnel» et revêtait une «importance nationale», aucune licence d’exportation ne devrait être délivrée, en application des paragraphes 11(1) et 11(3) de la Loi. Ainsi, conformément au paragraphe 13(1) de la Loi, l’agent a informé la demanderesse que la licence lui était refusée.
[6] La demanderesse a alors demandé à la Commission de réviser sa demande de licence d’exportation, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi. Une audience a été prévue devant un tribunal formé de trois commissaires, dont Mme Katherine Lochnan, qui avait récemment travaillé pour le Musée des beaux-arts de l’Ontario. La demanderesse et l’experte-vérificatrice ont toutes deux présenté des observations écrites, puis se sont vu remettre leurs observations réciproques afin d’avoir la possibilité de produire une contre-preuve. La demanderesse a demandé la possibilité de contre-interroger l’experte-vérificatrice pendant l’audience, mais la Commission a rejeté sa demande.
[7] Une audience a eu lieu devant la Commission le 7 juin 2017. La demanderesse et l’experte-vérificatrice ont toutes deux présenté des observations.
[8] Le 13 juillet 2017, la Commission a rendu sa décision. Elle a déterminé que la peinture présentait un «intérêt exceptionnel» et revêtait une «importance nationale», aux termes des paragraphes 29(3) et 11(1) de la Loi. Elle a également déterminé qu’un établissement ou une administration sis au Canada pourrait proposer un juste montant pour l’achat de cet objet, et a donc retardé pour une période de six mois la délivrance d’une licence d’exportation, conformément à l’alinéa 29(5)a) de la Loi.
[9] Le 10 août 2017, la demanderesse a déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission. Une version modifiée de cette demande a été présentée le 11 octobre 2017.
III. Questions en litige
[10] Les questions en litige sont les suivantes:
A. La Commission a-t-elle rendu une décision déraisonnable? Plus particulièrement:
i. La Commission a-t-elle fait une interprétation déraisonnable de l’expression «importance nationale» énoncée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi?
ii. La Commission a-t-elle rendu une décision déraisonnable lorsqu’elle a déterminé que la peinture revêtait une «importance nationale»?
B. La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale en refusant à la demanderesse la possibilité de contre-interroger l’experte-vérificatrice?
C. La participation de la commissaire Katherine Lochnan à l’audience a-t-elle soulevé une crainte raisonnable de partialité?
IV. Norme de contrôle
[11] La norme de contrôle est celle de la décision correcte en ce qui concerne les questions relatives à l’équité procédurale, tandis qu’elle est celle de la décision raisonnable à l’égard de la décision de fond de la Commission.
V. Analyse
A. La Commission a-t-elle rendu une décision déraisonnable?
(1) La Commission a-t-elle adopté une interprétation déraisonnable de l’expression «importance nationale»?
[12] La demanderesse affirme que l’interprétation adoptée par la Commission à l’égard de l’expression «importance nationale» va à l’encontre du but et de l’objet de la Loi. Le législateur a voulu que les experts-vérificateurs et la Commission appliquent des normes élevées afin d’éviter de porter atteinte aux droits en matière de biens personnels. Toutefois, la Commission a adopté une interprétation si vaste que tout objet appartenant à la Nomenclature et satisfaisant au critère «intérêt exceptionnel» répondrait automatiquement à l’exigence relative à l’«importance nationale». Cette interprétation fait perdre tout son sens à l’exigence quant à l’importance nationale et vient miner l’intention du législateur de ne protéger que les objets qui sont étroitement liés à notre patrimoine national.
[13] Le défendeur soutient que la Loi traite expressément des biens culturels d’origine étrangère qui n’ont aucun lien direct avec le Canada, et que des contrôles rigoureux sont en place lorsque ces biens ont une forte valeur sur le marché et qu’ils se trouvent au Canada depuis plus de 35 ans. Autrement dit, un objet culturel d’origine étrangère est important pour notre patrimoine national lorsqu’il a une valeur élevée et que sa présence au Canada remonte à une époque éloignée. En outre, le critère relatif à l’«importance nationale» consiste en une évaluation quantitative qui est axée sur le niveau de qualité, d’importance ou de rareté, et la Commission a droit à une certaine déférence lorsqu’elle procède à cette évaluation.
[14] À mon avis, l’interprétation de la Commission quant à l’expression «importance nationale» est déraisonnable. Bien que le Canada soit un pays diversifié conciliant une multitude de traditions culturelles et que les Canadiens puissent souhaiter étudier leurs propres traditions culturelles ou celles d’autres Canadiens, cela ne suffit pas pour donner à un objet une importance nationale lorsque ni lui ni son créateur n’ont de lien avec le Canada. Cette interprétation va à l’encontre du texte et de l’économie de la Loi ainsi que de l’intention du législateur de limiter la portée de la Loi.
[15] Le paragraphe 11(1) de la Loi établit les critères à partir desquels doit être évalué un objet appartenant à la Nomenclature pour lequel une demande de licence d’exportation est présentée. Il faut déterminer si l’objet:
a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;
b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.
[Non souligné dans l’original.]
[16] Pour déterminer ce que représente «une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national», la Commission s’est appuyée sur le Guide pour l’exportation de biens culturels hors du Canada (le Guide), publié par le ministère du Patrimoine canadien en juin 2015. Elle a déclaré ce qui suit:
[traduction]
L’Annexe 3 du Guide précise une série de facteurs qui démontrent l’importance nationale dont pourrait tenir compte la Commission d’examen pour rendre sa décision. Ces facteurs comprennent la provenance de l’objet, l’importance de son créateur, son origine, son authenticité, son état, son caractère complet, sa rareté ou son caractère unique, sa représentativité, sa valeur documentaire ou de recherche ainsi que les associations contextuelles qu’il pourrait avoir.
[…]
La Commission d’examen estime que même si un objet ou son créateur n’a aucun lien avec le Canada, il peut revêtir le niveau d’importance nationale exigé par la Loi. Le Canada est un pays diversifié conciliant une multitude de traditions culturelles. La perte d’un objet au Canada pourrait grandement appauvrir le patrimoine national si elle empêchait un segment de la population de connaître ou d’étudier ses traditions culturelles ou celles d’autres Canadiens. Le Guide expose la question dans les termes suivants:
Aux fins de l’administration de la Loi, le terme patrimoine national comprend les biens culturels du Canada, ou du territoire qui est aujourd’hui le Canada, et les exemples importants de biens culturels étrangers qui démontrent la diversité culturelle du Canada ou qui permettent aux Canadiens de comprendre différentes cultures, civilisations, périodes et leur place dans l’histoire et dans le monde.
[17] Autrement dit, la Commission a conclu que même si un objet ou son créateur n’a aucun lien avec le Canada, il peut revêtir le niveau d’importance nationale si sa perte au Canada empêchait un segment de la population de connaître ou d’étudier ses traditions culturelles ou celles d’autres Canadiens.
[18] Pour déterminer si cette interprétation est raisonnable, il est nécessaire de lire les expressions «importance nationale» et «patrimoine national» en tenant compte du contexte et en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re)), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21).
[19] Le sens habituel donné à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sous-entend que l’objet doit avoir un lien direct avec le Canada. Selon une interprétation téléologique, le passage «revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national» fait immédiatement penser à une analyse visant à déterminer si un objet revêt une telle importance pour le Canada que son retrait représenterait une perte considérable d’une partie de la culture canadienne. À tout le moins, l’objet doit avoir des répercussions importantes sur la culture canadienne.
[20] L’exigence visant le lien direct avec le Canada est également corroborée par la définition que contient le dictionnaire à l’égard des mots «patrimoine» et «national». La définition du Le Petit Robert de la langue française, édition de 2017, pour le terme «national» comprend les passages «qui appartient à une nation, qui a pour objet une nation, particulièrement celle à laquelle on appartient» et «qui incarne ou prétend incarner et servir avant tout sa nation». Quant à la définition du terme «patrimoine», elle comprend les passages «biens de famille, biens que l’on a hérités de ses ascendants» et «ce qui est considéré comme un bien propre, comme une propriété, une richesse transmise par les ancêtres». Ensemble, les termes «patrimoine» et «national» exigent que l’objet revête non seulement une importance sur le plan culturel, mais également que cette importance soit propre au Canada et aux Canadiens.
[21] Cette interprétation est conforme avec l’économie générale de la loi. La plupart des objets appartenant à la Nomenclature doivent être directement liés au Canada, comme avoir été retrouvés au Canada, avoir été fabriqués au Canada, avoir été fabriqués par une personne ayant déjà résidé au Canada, ou autrement avoir un certain lien avec l’histoire du Canada ou un thème ou un sujet canadien. Bien que certains objets figurant dans la Nomenclature n’aient aucun lien apparent avec le Canada, mais dépassent tout simplement un âge ou une valeur en particulier, ces objets représentent l’exception, et non la norme.
[22] Quoi qu’il en soit, le fait qu’un objet figure dans la Nomenclature ne permet pas de déterminer si une licence d’exportation devrait être délivrée à son égard, mais donne plutôt lieu à une révision de la demande de licence d’exportation par un expert-vérificateur ou la Commission. Autrement dit, ces objets exceptionnels n’ayant aucun lien apparent avec le Canada doivent faire l’objet d’un examen approfondi en fonction de critères renforcés en matière d’«intérêt exceptionnel» et d’«importance nationale».
[23] Selon une interprétation téléologique, la référence à la fois à l’«intérêt exceptionnel»et à l’«importance nationale» sous-entend que ces deux critères sont indépendants et tiennent compte de facteurs distincts. Un objet peut présenter un intérêt exceptionnel en raison de son esthétique ou de son utilité pour effectuer des études, aux termes de l’alinéa 11(1)a) de la Loi, mais ces qualités sont indépendantes du critère indispensable voulant que l’objet revête également une importance nationale et fasse partie du patrimoine canadien, conformément à l’alinéa 11(1)b). Un objet doit à la fois présenter un intérêt et revêtir une importance nationale et faire partie du patrimoine canadien. Le fait d’insinuer qu’un objet revêt une importance nationale uniquement en raison de son utilité pour effectuer des études – comme l’a sous-entendu la Commission – jetterait du discrédit sur le deuxième critère et lui ferait perdre tout son sens. Les tribunaux devraient éviter d’adopter une interprétation qui dépouille une partie d’une loi de tout son sens ou qui la rend redondante (Ruth Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes, 6e éd. (Markham, Ontario: 2014, LexisNexis Canada) [Sullivan], page 211).
[24] En outre, le législateur n’a jamais adopté la définition beaucoup plus vaste énoncée dans la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, La Haye, 14 mai 1954, R. T. Can. 1999 nº 52 (la Convention). La Convention définit les «biens culturels» comme des objets «qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples». Or, bien que la Loi contienne des dispositions se rapportant à la Convention, elle ne comprend pas cette définition. Ainsi, le contraste marqué entre les expressions «patrimoine national» et «patrimoine culturel des peuples» laisse entendre une intention de limiter l’étendue des objets visés par la Loi.
[25] Enfin, l’historique législatif confirme que le législateur a voulu que la Loi ne s’applique que d’une manière limitée et mette l’accent sur les objets dont les liens avec le patrimoine canadien sont les plus directs. L’honorable James Hugh Faulkner, qui était secrétaire d’État au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, a parlé de la perte des «trésors nationaux» et de la «préservation du patrimoine canadien». Le député Gordon Fairweather a pour sa part parlé «du nationalisme canadien, de l’éthique canadienne et de notre héritage culturel», de même que de la nécessité d’éviter le retrait de nos trésors nationaux afin que les Canadiens puissent découvrir leur identité commune (Débats de la Chambre des communes, 30e législature, 1re session, Vol III (7 février 1975), Deuxième lecture du projet de loi C-33 (les Débats), pages 3024 à 3040).
[26] M. Faulkner a également souligné l’importance de limiter toute atteinte aux droits de propriété ainsi que la liberté accordée aux marchands. Il a voulu «insister sur la nécessité de limiter les contrôles au strict minimum», tout en affirmant que «[t]out bon système de contrôle des exportations doit se borner à un nombre limité de catégories bien définies» et ne porter que sur des objets «de la plus haute importance». Il a déclaré que la Loi ne devrait pas «[chercher] à être un filet trop fin qui ne laisserait pas passer des objets sans véritable importance nationale, ce qui ne ferait qu’engendrer des coûts administratifs élevés, causerait des retards inutiles et nuirait au commerce des antiquaires» (Débats, pages 3024 à 3040).
[27] L’interprétation rigoureuse de la Loi suggérée par M. Faulkner concorde avec l’intention présumée du législateur de ne pas porter atteinte aux droits de propriété, en particulier de laisser au propriétaire du bien la liberté d’utiliser et d’aliéner ce dernier comme bon lui semble, sans entrave ni contrôle (Sullivan, page 503).
[28] Il ne fait aucun doute que le Canada est un pays diversifié conciliant une multitude de traditions culturelles. Je reconnais également que la Commission a droit à une certaine déférence lorsqu’elle interprète sa loi constitutive et que la demanderesse doit non seulement démontrer que son interprétation différente de la Loi est raisonnable, mais également que l’interprétation de la Commission est déraisonnable (McLean c Colombie-Britannique (Securities Commission), 2013 CSC 67, au paragraphe 41).
[29] Toutefois, il est déraisonnable d’appliquer les dispositions de la Loi à tout objet qui favorise la connaissance ou l’étude des traditions culturelles des Canadiens, lorsque l’expression «traditions culturelles» incorpore le multiculturalisme du Canada, et donc le patrimoine culturel des peuples à l’échelle mondiale, sans bien tenir compte du libellé spécifique du paragraphe 11(1) de la Loi.
[30] Une telle interprétation pourrait déraisonnablement englober toute oeuvre présentant des qualités esthétiques ou une utilité pour effectuer des études, mais aucun lien avec le Canada ni aucune importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national. Le lien avec le patrimoine canadien doit être plus direct que le fait que le Canada est un pays multiculturel et que les Canadiens pourraient vouloir étudier les traditions de l’un des nombreux pays d’où auraient pu provenir leurs ancêtres. Le législateur a retenu des termes qui exigent qu’il existe un lien direct avec le patrimoine culturel propre au Canada et a choisi de ne pas adopter la définition générale de «bien culturel» énoncée dans la Convention et de traiter l’analyse des qualités esthétiques et de l’utilité pour effectuer des études la valeur séparément de l’analyse de l’importance nationale. Cette façon de procéder concorde avec l’intention énoncée et présumée du législateur de restreindre la portée de la Loi afin de limiter toute atteinte aux droits de propriété.
[31] J’estime que l’interprétation de l’alinéa 11(1)b) qu’a adoptée la Commission n’appartient pas aux issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit, et qu’elle était donc déraisonnable.
(2) La Commission a-t-elle rendu une décision déraisonnable lorsqu’elle a déterminé que la peinture revêtait une «importance nationale»?
[32] Le défendeur affirme que la Commission a rendu une décision raisonnable lorsqu’elle a déterminé que la peinture devait être conservée au Canada afin d’en assurer l’accès aux Canadiens et qu’elle avait un lien avec une oeuvre impressionniste qui était actuellement exposée au Musée des beaux-arts du Canada. La Commission avait tenu compte des opinions fournies par les experts auxquels a fait appel la demanderesse, mais n’était pas du même avis que cette dernière au sujet de la valeur probante et le poids de ces éléments de preuve.
[33] Dans sa décision voulant que la perte de la peinture au Canada appauvrirait gravement le patrimoine national, la Commission a évoqué les motifs suivants:
- la peinture figurait dans l’inventaire du marchand commercial Ambroise Vollard, de Paris, en France, lequel a été l’un des plus importants marchands en matière d’art moderne français du début du XXe siècle, notamment à l’égard des oeuvres des impressionnistes français;
- les oeuvres de Gustave Caillebotte ont été réévaluées au cours des 20 dernières années, et elles suscitent maintenant un vif intérêt;
- cette peinture n’est que la deuxième oeuvre de Caillebotte à figurer dans les collections canadiennes. Cette oeuvre d’art unique est le seul exemplaire de l’ensemble des oeuvres représentant des fleurs et ayant une signification symbolique qui ont été créées par l’artiste à la fin de sa vie;
- compte tenu de la rareté des oeuvres produites par Caillebotte au Canada et de l’importance de cet artiste dans l’impressionnisme français, il ne fait aucun doute que la peinture présentera un grand intérêt et sera importante pour les travaux de recherche effectués au Canada à l’égard de l’impressionnisme français;
- en ce qui concerne le contexte canadien, l’un des plus grands chefs-d’oeuvre exposés au Musée des beaux-arts du Canada est le tableau Iris, peint par Vincent Van Gogh en 1890, soit seulement deux ans avant la peinture de Caillebotte, qui illustre également un iris bleu dans un jardin sous un angle similaire à celui de la peinture de Caillebotte.
[34] Les experts auxquels a fait appel la demanderesse pour traiter de la question sont Laurier Lacroix et Carol Lowrey. M. Lacroix est professeur émérite de l’Université du Québec à Montréal, où il a enseigné l’histoire de l’art et la muséologie. Il a consacré la majeure partie de sa vie professionnelle aux peintres du Québec et a mené de nombreuses recherches sur les artistes canadiens ayant été influencés par le mouvement impressionniste français. Mme Lowrey est pour sa part une conservatrice et historienne de l’art qui est née au Canada, mais vit maintenant à New York. Elle est diplômée de l’Université de Toronto (maîtrise ès arts, maîtrise en bibliothéconomie et en science de l’information) et de la City University of New York (doctorat en philosophie), et a rédigé de nombreux articles, livres et catalogues d’exposition consacrés aux aspects de l’art canadien et américain du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Elle a concentré ses efforts sur la tradition de l’impressionnisme telle qu’elle a évolué au Canada.
[35] Dans son rapport d’expert, M. Lacroix a affirmé ce qui suit: [traduction]
- la peinture était plutôt sans intérêt;
- la peinture n’avait jamais été exposée au Canada et n’avait été reproduite qu’en 1978, soit bien après la fin de la période de l’impressionnisme canadienne;
- la peinture n’avait exercé aucune influence sur les peintres impressionnistes canadiens;
- la peinture n’avait exercé aucune influence sur la population canadienne ni sur les pratiques artistiques des artistes canadiens;
- aucun fondement raisonnable ne permettait de conclure que l’exportation de la peinture à l’extérieur du Canada nuirait au patrimoine national de quelque façon que ce soit.
[36] Dans son rapport d’expert, Mme Lowrey a affirmé ce qui suit: [traduction]
- rien n’indiquait que la peinture, ou l’oeuvre de Caillebotte en général, avait inspiré l’évolution stylistique de l’un des artistes associés à la tradition impressionniste canadienne;
- rien n’indiquait que les artistes canadiens étaient en contact avec Caillebotte;
- la peinture n’avait pas été exposée pendant les années où l’impressionnisme avait été prospère au Canada, puisqu’elle était demeurée à l’étranger jusqu’à son arrivée dans une collection privée, en 1960;
- la peinture n’avait aucun lien direct avec l’histoire de la tradition impressionniste canadienne;
- l’exportation de la peinture n’aurait aucune incidence sur notre interprétation de l’impressionnisme telle qu’elle était exercée par les artistes canadiens ni n’aurait d’effet néfaste sur notre patrimoine national.
[37] La Commission a pris acte de l’opinion de ces experts, à savoir que la peinture n’avait aucun lien avec l’impressionnisme canadien, n’avait exercé aucune influence sur la population canadienne ni sur les pratiques artistiques des artistes canadiens et n’avait aucun lien avec les artistes canadiens exerçant l’impressionnisme.
[38] Il s’agit là des types de facteurs précis dont la Commission aurait dû tenir compte dans son analyse au titre de l’alinéa 11(1)b) de la Loi. La Commission a agi de façon déraisonnable lorsqu’elle s’est concentrée uniquement sur la provenance, la rareté, la valeur de recherche et l’attrait au titre de l’alinéa 11(1)a). Comme il a été mentionné précédemment, le fait de n’analyser que ces facteurs sans tenir compte du lien de l’objet avec le Canada fait perdre tout son sens au paragraphe 11(1)b) et élargit exagérément la portée de la Loi, ce qui est contrait à l’intention du législateur.
[39] Aucun fondement raisonnable ne permettait à la Commission de conclure que la peinture revêtait une importance nationale telle que sa perte au Canada appauvrirait gravement le patrimoine national. Ni l’artiste ni l’objet n’étaient canadiens, et la peinture n’avait aucun lien avec la population canadienne ni avec l’impressionnisme canadien. Essentiellement, en raison de son interprétation déraisonnable de l’alinéa 11(1)b) de la Loi, la Commission a rendu une décision déraisonnable lorsqu’elle a déterminé si la peinture satisfaisait aux exigences de cette disposition.
[40] La Commission a rendu une décision déraisonnable à l’égard de cette question.
B. La Commission a-t-elle manqué à l’équité procédurale en refusant à la demanderesse la possibilité de contre-interroger l’experte-vérificatrice?
[41] La demanderesse affirme que la Commission a manqué à l’équité procédurale en lui refusant la possibilité de contre-interroger l’experte-vérificatrice. La possibilité de contre-interroger est essentielle pour qu’une partie puisse faire valoir sa position et répondre aux arguments présentés contre elle, en particulier lorsqu’un tribunal mène une audience portant sur les droits de propriété et que les faits contestés sont complexes. En l’espèce, l’experte-vérificatrice était essentiellement une partie opposée, et sa preuve contenait la totalité des arguments auxquels devait répondre la demanderesse.
[42] Le contenu de l’équité procédurale est contextuel et, en l’espèce, le contexte favorise une procédure très éloignée des «attributs» d’un processus judiciaire. La Commission a fourni des renseignements substantiels au sujet du processus avant la tenue de l’audience. Pendant cette dernière, elle a donné à la demanderesse de nombreuses occasions de répondre à l’opinion de l’experte-vérificatrice et de présenter sa propre preuve.
[43] En l’espèce, les facteurs ayant une incidence sur le contenu du devoir d’équité, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 21 à 28, ne jouent pas en faveur d’un niveau de protection procédurale plus élevé que celui offert par la Commission.
[44] La demanderesse ne pouvait légitimement s’attendre à avoir la possibilité de contre-interroger l’experte-vérificatrice. En outre, la question de savoir si un objet présente un «intérêt exceptionnel» et revêt une «importance nationale» est subjective, et la Commission a droit à une certaine déférence à l’égard de la procédure qu’elle choisit d’adopter pour rendre sa décision. En effet, le législateur a accordé à la Commission le vaste pouvoir discrétionnaire d’établir ses propres règles à l’égard du déroulement de l’instance (article 24 de la Loi) et de régler les affaires dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent les circonstances relatives à l’équité (article 28 de la Loi).
[45] Bien que j’accepte que de nombreux aspects du processus décisionnel de la Commission laissaient entendre qu’il s’agissait d’un processus de nature juridictionnelle – la décision était définitive, avait des répercussions sur les droits de la demanderesse et reposait sur des conclusions de fait et sur la question de savoir si certaines normes juridiques étaient satisfaites – je conclus que les procédures de la Commission respectaient les règles de la justice naturelle. Avant la tenue de l’audience, la Commission a précisé le processus qui serait suivi. La demanderesse s’est fait remettre à l’avance les déclarations écrites de l’experte-vérificatrice. Elle a alors répondu à ces déclarations au moyen d’observations, de rapports d’experts et d’une contre-preuve subséquente. Au cours de l’audience, du temps supplémentaire lui a été accordé pour présenter ses arguments, et plus de temps encore pour répondre aux arguments verbaux de l’experte-vérificatrice.
[46] Compte tenu des circonstances, je suis convaincu que la demanderesse a eu droit à l’équité procédurale.
C. La participation de la commissaire Katherine Lochnan à l’audience a-t-elle soulevé une crainte raisonnable de partialité?
[47] La demanderesse affirme que la participation de la commissaire Katherine Lochnan à l’audience soulève une crainte raisonnable de partialité. Mme Lochnan avait travaillé pour le Musée des beaux-arts de l’Ontario pendant 47 ans et, au moment de l’audience, elle travaillait à cet endroit comme conservatrice principale des expositions internationales ou venait de quitter ce poste pour prendre sa retraite. Pendant l’audience, l’experte-vérificatrice avait déclaré que le Musée des beaux-arts de l’Ontario s’était montré intéressé à acheter la peinture. À ce moment, Mme Lochnan aurait dû faire part de son lien avec le Musée des beaux-arts de l’Ontario afin de donner à la demanderesse la possibilité de demander sa récusation. Ce problème s’est exacerbé lorsque le Musée des beaux-arts de l’Ontario a offert d’acheter la peinture au cours de la période de délai imposée par la Commission.
[48] Il incombait à la demanderesse de prouver la partialité, et les motifs visant une crainte de partialité doivent être substantiels, puisqu’une telle allégation met en doute l’intégrité d’un tribunal et des commissaires prenant part à une décision. La Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, dont la présomption d’intégrité des décideurs désignés par la loi, la nature des tribunaux administratifs et la nature d’une instance précise.
[49] En l’espèce, les paragraphes 18(2) et 18 (4) de la Loi prévoient non seulement que des agents ou des employés, anciens ou actuels, des établissements artistiques peuvent être membres de la Commission, mais également qu’au moins l’une de ces personnes doit être présente pour former un quorum:
| Commission Création de la Commission Commissaires 18 (2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis: a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada; b) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national. | Review Board Review Board Established Members 18 (2) The Chairperson and one other member shall be chosen generally from among residents of Canada, and (a) up to four other members shall be chosen from among residents of Canada who are or have been officers, members or employees of art galleries, museums, archives, libraries or other collecting institutions in Canada; and (b) up to four other members shall be chosen from among residents of Canada who are or have been dealers in or collectors of art, antiques or other objects that form part of the national heritage. |
| Quorum (4) Le quorum est de trois membres, dont au moins un de chacune des deux catégories établies par les alinéas (2)a) et b). [soulignement ajouté] | Quorum (4) Three members, at least one of whom is a person described in paragraph (2)(a)and one of whom is a person described in paragraph (2)(b), constitute a quorum of the Review Board. [Emphasis added] |
[50] Le législateur souhaitait visiblement que la Commission profite de l’expertise de personnes provenant d’établissements artistiques. En outre, aucune disposition de la Loi ne sous-entend que la présence de ces personnes au sein de la Commission est problématique lorsque celle-ci rend des décisions qui pourraient avantager ces mêmes établissements. Au contraire, aux termes de l’alinéa 29(5)a), il est nécessaire de déterminer si un établissement artistique canadien peut proposer un juste montant pour l’achat d’un objet, et les personnes de ces établissements artistiques sont bien placées pour rendre une telle décision. Pour étayer une crainte de partialité, un simple lien entre un commissaire et un établissement artistique prévu par la loi n’est pas suffisant.
[51] En l’espèce, absolument rien ne laisse entendre que Mme Lochnan était partiale, si ce n’est de son ancien lien avec le Musée des beaux-arts de l’Ontario. Aucun élément de la transcription de l’instance ou du dossier dont était saisie la Commission ne permet d’étayer la crainte de partialité alléguée, et rien n’indique que Mme Lochnan a personnellement participé aux questions touchant la peinture pendant qu’elle travaillait au Musée des beaux-arts de l’Ontario.
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT:
1. La demande est accueillie et la décision de la Commission est annulée. L’affaire est renvoyée à une Commission différemment constituée pour que celle-ci procède à un nouvel examen en fonction de mes motifs et de ma décision.
2. La demande est rejetée à tous autres égards.
3. Les dépens sont accordés à la demanderesse.
Michael D. Manson
Juge